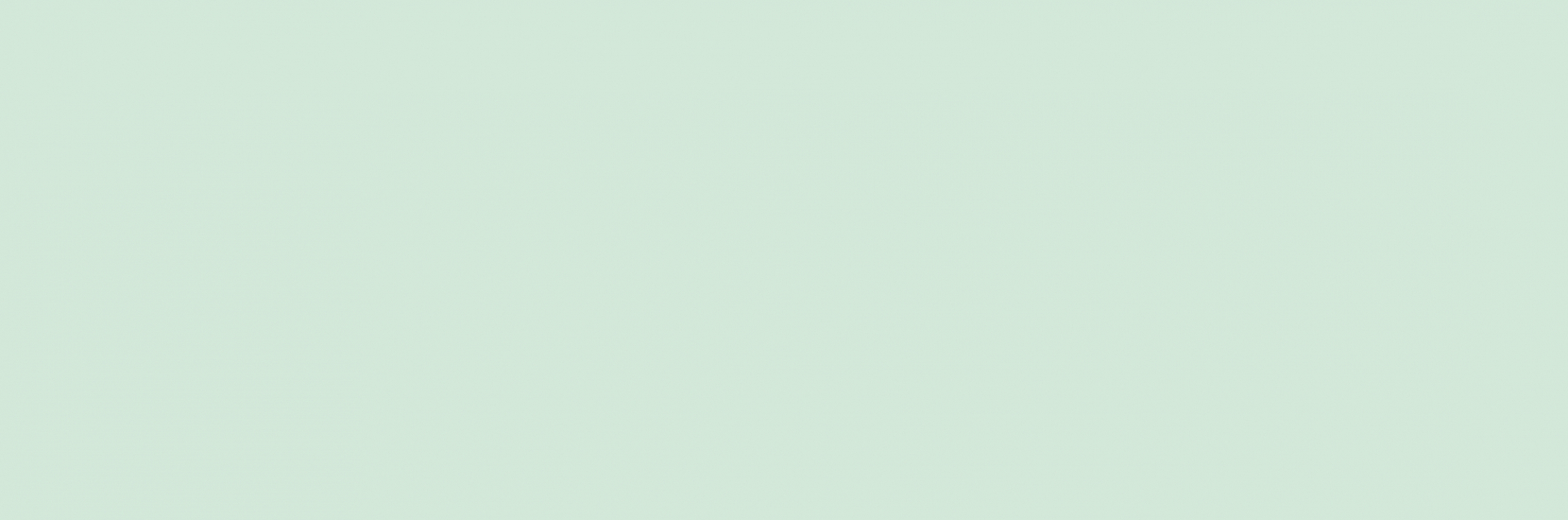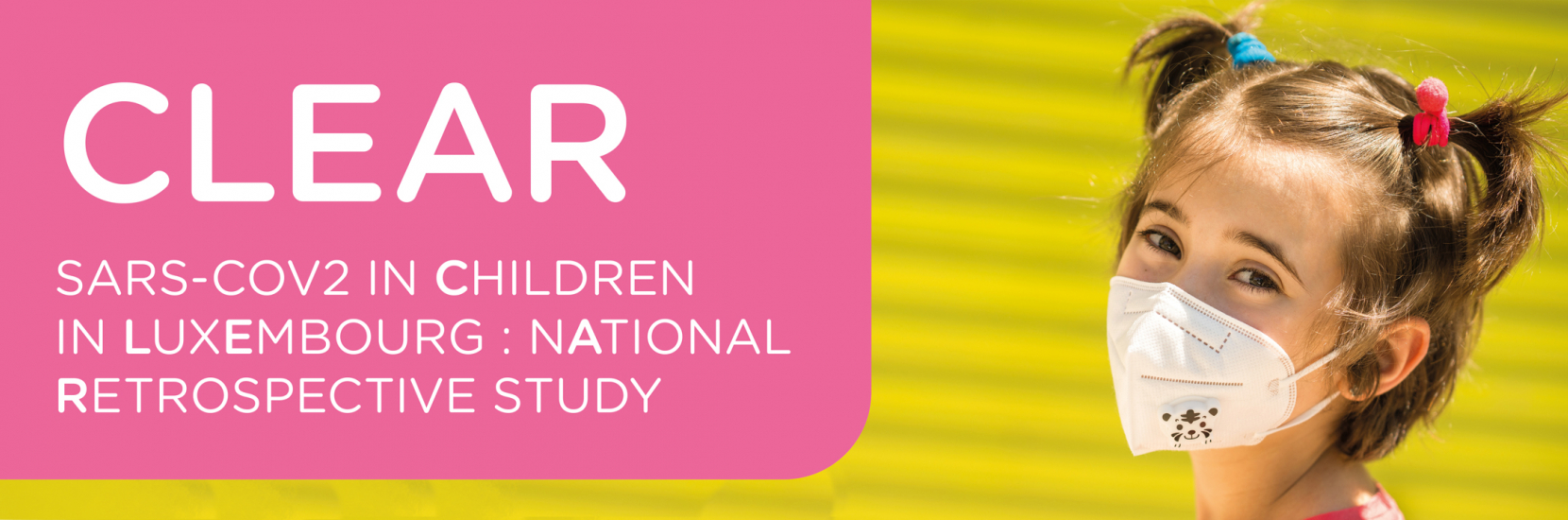La direction du CHL a récemment reçu une délégation de l'association don de moelle Luxembourg dans le cadre d'une cérémonie de remerciement de collaboration.
Le président de l'Association, M. Steve Guiliani, a souligné l'importance de cette collaboration qui a pour objectif de permettre une intégration des personnes volontaires sur des listes de donneurs de moelle. L'inscription se fait dans une base de données de la "Stefan Morsch Stiftung", située à Birkenfeld en Allemagne.
Lors de la cérémonie, le Dr Nati a souligné l'importance de l'engagement des membres de l'Association pour permettre aux patients atteints d'un cancer hématologique de bénéficier d'une greffe de moelle et de leur donner une chance de guérison, Il a aussi exprimé sa gratitude envers les collaborateurs du CHL qui s'engagent dans cette collaboration.
M.Patrick Schmit a fait une présentation pour rappeler l'historique de notre partenariat.
M Rizo Agovic, ambassadeur de patients, a tenu à remercier le CHL pour la prise en charge holiste des patients au sein de son service national d'onco-hématologique et pour oeuvrer si activement dans les traitements des patients leucémiques.
Dans ce contexte, le Dr Goergen a souligné les progrès de la médecine qui permettent de donner aujourd'hui une sérieuse perspective aux patients atteints d'une leucémie.
Cette collaboration a été mise en place en 2017. Des campagnes de sensibilisation grand public et une sensibilisation auprès du personnel du CHL avaient permis le recueil de 279 nouvelles inscriptions en tant que donneurs de moelle potentiels.
En 2020, 95 donneurs potentiels ont pu être sélectionnés pour aider un patient souffrant d'un cancer du sang. 14 ont été retenus après tous les critères stricts de sélection. Cette année, nous sommes déjà au nombre de 22.
Plus d'informations sur le don moelle: www.dondemoelle.lu