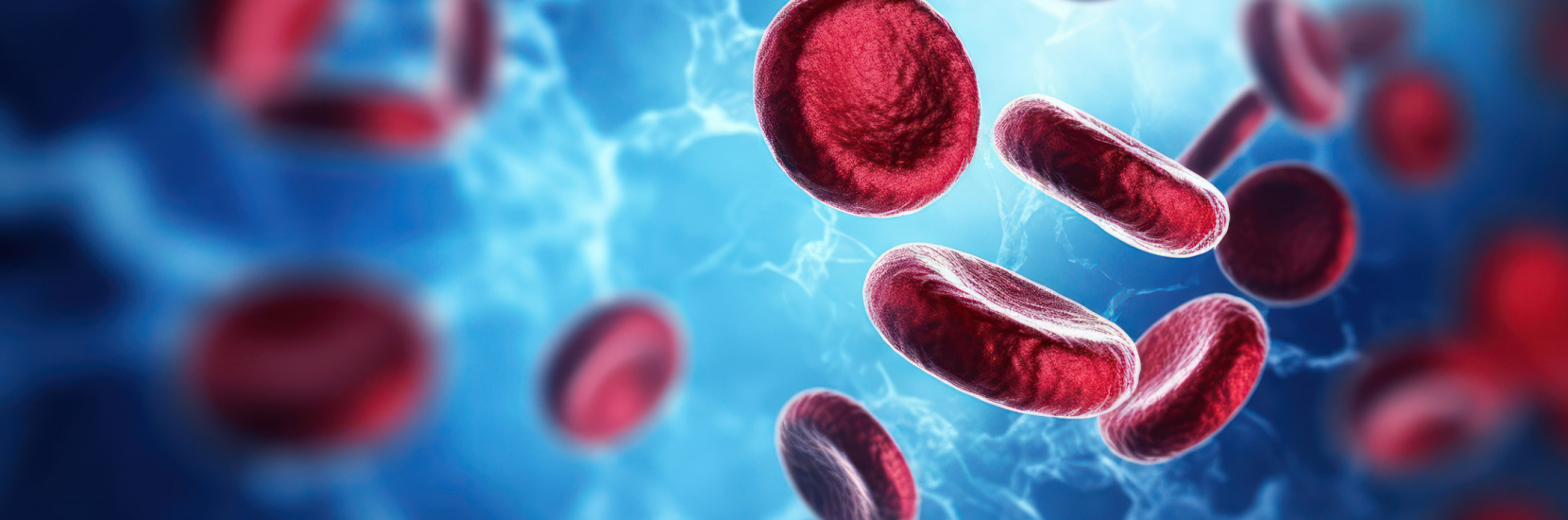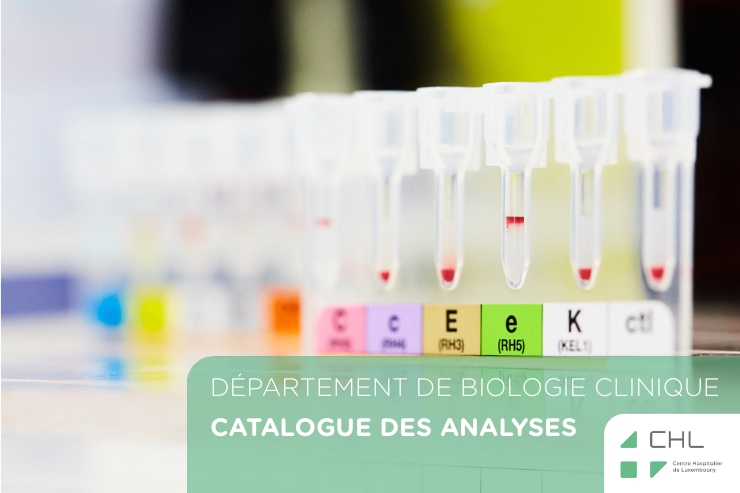POURQUOI UNE SAIGNÉE ?
La saignée est un prélèvement de sang pratiqué pour traiter des surcharges sanguines. Elle est prescrite principalement en cas d'hyperferritinémie, d'hémochromatose génétique ou de polyglobulie.
COMMENT SE DÉROULE LA SÉANCE ?
La saignée ressemble à un don de sang. Vous serez confortablement allongé ou en position demi-assise. Elle est réalisée par ponction veineuse (introduction d'une aiguille dans la veine du pli du coude ou du bras). L'aiguille est reliée à une poche dans laquelle s'écoule le sang à éliminer.
Le prélèvement dure environ 10–15 minutes. La fréquence ainsi que le volume prélevé dépendent de la prescription médicale.
Le soignant mesure votre tension artérielle avant de débuter la saignée. Une fois réalisée, un contrôle est à nouveau effectué afin d'évaluer la tolérance.
› Il est important de garder le bras immobile et tendu tout au long du prélèvement.
AVANT ET APRÈS LA SÉANCE : CONSEILS PRATIQUES
- Avant la séance : Mangez un repas et buvez abondamment (minimum 1L). Vous pouvez apporter une collation sucrée (barre de céréales, bonbon) et une bouteille d'eau, un soda/jus....
- Après la séance : Buvez beaucoup d’eau (minimum 2L).
- Reposez-vous : évitez les efforts physiques intenses (sport et port de charges lourdes) pendant 24–48 h.
- Évitez l’alcool et la caféine le reste de la journée.
Le plus souvent, il n’y a pas de régime alimentaire particulier à suivre, une alimentation équilibrée et une bonne hydratation sont suffisantes.
En cas de non respect des conseils avant la saignée, celle-ci devra être reportée.
EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES
La plupart des patients tolèrent bien la saignée. Cependant, quelques effets peuvent survenir :
- Légère faiblesse ou vertige juste après le prélèvement (mal de tête, sensation de « tête qui tourne »).
- Douleur locale, rougeur ou petit hématome au point de ponction (petit bleu).
- Un saignement prolongé ou un gonflement inhabituel doit être signalé au personnel.
Ces effets indésirables sont sans gravité et temporaire. Ils sont limités par les mesures de repos et d’alimentation/ hydratation mentionnées.
En cas de mauvaise tolérance, le médecin adaptera les modalités de la procédure.
VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
Vous pouvez nous contacter au : +352 4411 6600 de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30.
Hôpital de jour UTC (bureau n°10, 1er étage)
Réf. : Flyer Saignee Mai 2025