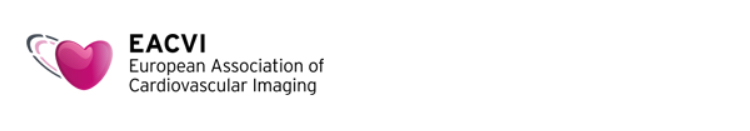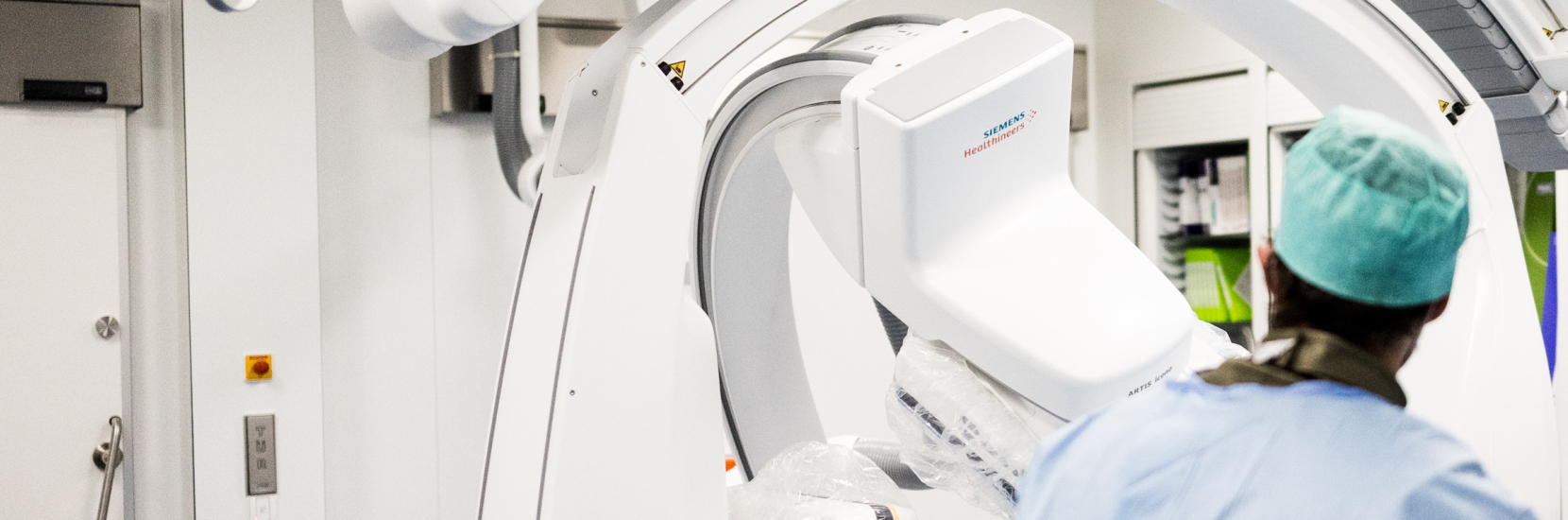Depuis de nombreuses années, le CHL s’engage activement dans une démarche d’amélioration continue par la mise en place d’un système de management de la qualité. À ce titre, le CHL a défini une politique qualité ambitieuse, visant entre autre à :
- améliorer la qualité et la sécurité des soins proposés pour une satisfaction optimale du patient,
- permettre à l’institution de progresser sur les plans techniques et organisationnels.
En se soumettant régulièrement à des processus d’accréditation et de certification, le CHL fait reconnaître par des organismes externes indépendants, sa compétence ou sa conformité vis-à-vis de référentiels spécifiques.
Notre hôpital est fier de posséder aujourd’hui l’une des accréditations les plus complètes au monde : l’accréditation JCI. Après une première accréditation délivrée en juin 2018, le CHL a été réaccrédité en mars 2022 par la Joint Commission International (JCI), témoignant encore une fois de la qualité et de la sécurité des soins proposés. Le CHL fut le premier hôpital accrédité dans son intégralité au Luxembourg et il fait partie des 650 hôpitaux à avoir répondu aux niveaux d’exigence très pointus du référentiel de la JCI, organisme américain indépendant pionnier dans le système d’accréditation des établissements de santé.
Vous trouverez, ci-dessous, la liste des accréditations et certifications obtenues par le CHL :
ACCRÉDITATIONS ET CERTIFICATIONS :
JOINT COMMISSION INTERNATIONAL (JCI)

Référentiel :
Accreditation standards for hospitals
Concerne :
Ensemble du CHL
Date officielle d’accréditation/de certification :
Après une première accréditation délivrée en juin 2018, le CHL a été réaccrédité en mars 2022 par la Joint Commission International (JCI), témoignant encore une fois de la qualité et de la sécurité des soins proposés aux patients. Le CHL fut le premier hôpital accrédité dans son intégralité au Luxembourg et il fait partie des 650 hôpitaux à avoir répondu aux niveaux d’exigence très pointus du référentiel de la JCI, organisme américain indépendant pionnier dans le système d’accréditation des établissements de santé.
Durée de validité : 3 ans
En savoir plus
ISO 9001

Référentiel :
Système de management de la qualité
Concerne :
ISO 15189 : 2012

Référentiel :
Exigences particulières concernant la qualité et la compétence professionnelle
Concerne :
REGIONALES TRAUMAZENTRUM

Référentiel :
Certifié selon la certification TraumZentrum Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU)
Concerne :
Ensemble des services touchés par la prise en charge d’un patient polytraumatisé
Date officielle de certification :
Certifié depuis 2017. Durée de validité : 3 ans.
En savoir plus
EUROPEAN CANCER CENTRES – BREAST CANCER CENTRE

Référentiel :
Système européen de certification de la Deutsche Krebsgesellschaft (DKG)
Concerne :
Kriibszentrum – Clinique du sein
Date officielle de certification :
Certifié depuis 2021. Durée de validité : 3 ans.
En savoir plus
EUROPEAN ASSOCIATION OF CARDIOVASCULAR IMAGING
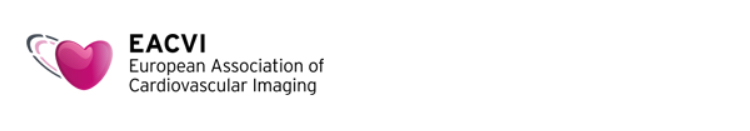
Référentiel :
European Association of CardioVascular Imaging
Concerne :
- Laboratoire d’échographie cardiaque : échographie de stress, échographie transthoracique, échographie trans oesophagienne
Date officielle de certification :
- Accrédité depuis 2022. Durée de validité : 5 ans.
EUROPEAN STROKE ORGANISATION

Référentiel :
European Stroke Organisation
Concerne :
- Prise en charge des patients ayant eu un accident vasculaire cérébral
Date officielle de certification :
- Certifié depuis 2022. Durée de validité : 5 ans.
AUTRES LABELS, DÉMARCHES ET PRIX :
SUPERDRECKSKËSCHT FIR BETRIBER

Référentiel :
Gestion écologique des déchets dans l’entreprise selon la norme DIN EN ISO 14024
Concerne :
- CHL Centre, CHL KannerKlinik et CHL Maternité. Label obtenu depuis 2011. Durée de validité : 2 ans.
- CHL Eich. Label obtenu depuis 2001. Durée de validité : 2 ans.
- Crèche « Les copains d’abord ». Label obtenu depuis 2014. Durée de validité : 2 ans.
ENTREPRISE SOCIALEMENT RESPONSABLE

Référentiel :
Le label ESR reconnaît les efforts liés aux trois piliers « Gouvernance », « Social et Égalité des chances professionnelles, et « Environnement ».
Concerne:
Ensemble du CHL.
Date officielle de certification :
Label obtenu depuis 2011. Durée de validité : 3 ans.
En savoir plus
SOU SCHMAACHT LETZEBUERG

Référentiel :
Convention gastronomie. Partenariat agriculture-gastronomie : les produits issus du terroir luxembourgeois.
Concerne:
Catering CHL Site Barblé. Restaurant d’entreprise et cafétérias Site Barblé.
Date officielle de certification :
Convention reçue depuis 2017. Durée de validité : illimitée.
En savoir plus
EFQM ET GLOBAL EFQM AWARD 2021

Référentiel :
Le modèle d’excellence EFQM.
Concerne :
Ensemble du CHL.
Date officielle de certification :
Depuis 2003, le CHL transpose le modèle qualité structuré EFQM (European Foundation for Quality Management).
Reçu le Global EFQM award 6 stars 2021.
GOLD PRIZE - PRIX LUXEMBOURGEOIS DE LA QUALITÉ ET DE L’EXCELLENCE

Référentiel :
Prix décerné par le Ministère de l’Économie et organisé par le Mouvement Luxembourgeois pour la Qualité et l’Excellence (MLQE).
Concerne :
Ensemble du CHL.
Date officielle de certification :
Prix décerné en novembre 2019. Il s’agit du Luxembourg Gold Quality Prize pour la catégorie grande entreprise.
En savoir plus